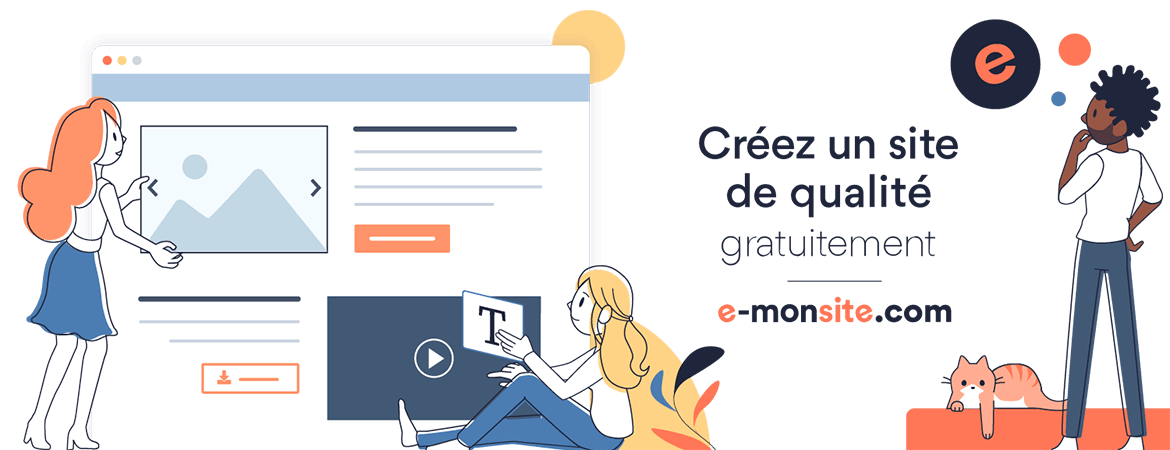Economie & Environnement : droit, infraction, ...
- Le 13/04/2015
- Dans Actualités de l'Environnement
Le droit de l'environnement concerne l'étude ou l'élaboration de règles juridiques visant la compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses formes - terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non-terrestres (droit spatial).
C'est un droit technique et complexe, local et global (européen, droit de la mer, international…) en pleine expansion, dont les champs tendent à se densifier au fur et à mesure des avancées sociales, scientifiques et techniques. Il est dans un nombre croissant de pays matérialisé dans un code de l'environnement, mais sans juridiction spécialisée à ce jour (il n'y a pas de juge de l'environnement, comme il peut y avoir un juge à l'enfance, ou une spécialité criminelle, anti-terroriste, etc.). Les juges et les cours de justices s'appuient sur des experts agréés, et des laboratoires également agréés. Dans certains pays il existe des services de polices, douanes ou garde-côte ayant une spécialité environnement.(source wikipedia)
Liens :
- Code de l'environnement (Version consolidée au 1er avril 2015) :

- Charte de l'environnement de 2004 (LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)) :

|
26-03-2015 |
La Commission demande à la FRANCE d'améliorer les procédures relatives à l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement |
|
|
28-01-2015 |
Comment mobiliser les collectivités au respect du droit de l'environnement ? |
|
|
13-06-2013 |
Environnement : une dizaine de procédures engagées contre la France | |
| janvier -2004 |
Conseil Constitutionnel - Vers un droit de l'environnement renouvelé - Michel PRIEUR |
L'Etude d'Impact sur l'environnement ou évaluation environnementale
L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, d’un document de planification ou d’un plan ou programme, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regards des enjeux identifiés sur le territoire du projet, plan ou programme ou document d’urbanisme. L’évaluation environnementale vise ainsi à prévenir les dommages potentiels, à une phase pertinente de conception du projet envisagé. L’évaluation environnementale ne doit donc pas être réalisée lorsque tous les choix relatifs à l’élaboration du projet, plan ou programme sont finalisés.
L’évaluation environnementale est toujours réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet /ou pétitionnaire du plan ou programme/ou du pétitionnaire du document d’urbanisme.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population, faune, flore, habitats naturels, sites et paysages, biens matériels, facteurs climatiques, continuités écologiques, équilibres biologiques, patrimoine, sol, eau, air, bruit, espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, ainsi que les interactions entre ces éléments.
L’évaluation environnementale doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet ou document de planification, et aux effets de sa mise en œuvre. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire.
Cette démarche implique de nombreux acteurs, dont notamment :
- le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire qui élabore et évalue son projet, plan ou programme ou document d’urbanisation ;
- l’autorité administrative qui autorise ou approuve le projet ou document ;
- l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, dite « autorité environnementale », qui donne un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la façon dont l’environnement a été pris en compte dans le projet, le plan ou le programme ou le document d’urbanisme.
- le grand public et ses représentants (association...).
(source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-evaluation-environnementale-qu.html)
Pourquoi doit-on respecter l’environnement et le patrimoine commun ?
L’environnement et le patrimoine communs doivent être respectés, d’abord parce que c’est une obligation juridiquement sanctionnée.
En effet, depuis une trentaine d’années , le droit de l’environnement s’est développé et s’exprime largement par des sanctions pénales (par exemple, en matière d’installations classées, telles qu’industries chimiques ou élevage intensif de porcs).
Mais, la préservation de l’environnement et du patrimoine devient depuis quelques années un enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les générations futures. Les richesses naturelles de la terre ne sont pas illimitées et des comportements, qu’ils soient le fait d’individus (surconsommation d’énergie ou d’eau) ou d’entreprises (pollution des rivières) les mettent en danger. De même, le patrimoine mondial de l’humanité (monuments, paysages) constitue un héritage à protéger afin de le transmettre sans dégradation. Dans ces conditions, leur préservation devient, lentement, une priorité nationale et internationale. Ceci d’autant plus que nombre de pays en voie de développement, grâce aux progrès économiques réalisés, adoptent peu à peu un mode de vie à l’occidentale qui implique une consommation d’énergie et une pollution accrues.
Des conférences internationales tentent de coordonner les initiatives des États en matière de protection de l’environnement. Ainsi, la conférence de Kyoto, organisée par les Nations unies en décembre 1997, a abouti à la signature d’un protocole entré en vigueur le 16 février 2005 et visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre . De même, l’UNESCO établit depuis 1972 une liste du patrimoine mondial. Des sites culturels ou naturels y sont inscrits, interdisant toute destruction ou modification.
En France, la réforme constitutionnelle du 1er mars 2005 a établi que la loi déterminerait les " principes fondamentaux de la préservation de l’environnement " (art. 34) et a intégré à la constitution la Charte de l’environnement. Celle-ci proclame notamment que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et que les politiques publiques doivent promouvoir au développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. ...
P n’imprimer que si cela est nécessaire
©2014-2015 association-capre06
environnement pollution France économie droit infraction gestion-risques impact-environnement